
Dans son rapport annuel sur les politiques publiques à destination des jeunes, la Cour des comptes dresse un état des lieux des dispositifs mis en place par les pouvoirs publics pour accompagner les “jeunes”. Pour délimiter ce public, le rapport se base sur les dispositifs d’aide existants, qui commencent à 18 ans et s’étendent jusqu’à 30 ans. Le rapport aborde des thématiques variées comme l’accès à l’éducation, la santé publique ou encore les politiques visant à favoriser l’entrée dans la vie active des jeunes. Le rapport étudie également la question de l’accès au logement de ce public. En ce qui concerne le logement, le rapport met en lumière deux tendances dans les politiques publiques : l’accès au logement de droit commun et le développement d’une offre leur étant spécifiquement dédiée.

I. Les jeunes, un groupe social homogène ?
Les politiques publiques rencontrent des difficultés à qualifier le public jeune, cela s’explique notamment par une représentation d’un groupe social homogène. Or, le rapport remet en cause cette approche en distinguant plusieurs groupes au sein du public “jeune”. Plusieurs variables permettent de comprendre les écarts entre les jeunes dans l’accès à un premier logement. Le niveau de diplôme, le genre, l’activité professionnelle. L’entrée à l’université et dans le monde professionnel implique une mobilité interrégionale pour nombre d’entre eux afin de rejoindre les centres urbains denses. Pour les personnes de 20 à 24 ans, les déménagements d’une région à l’autre sont deux fois plus fréquents en comparaison avec le reste de la population. Cependant, les jeunes dont les parents habitent déjà des métropoles ne rencontrent pas les mêmes problématiques que ceux étant obligé de quitter le domicile familial pour accéder aux études ou à un premier emploi. Les jeunes sans emploi sont 48% à habiter chez leurs parents contre 28% en emploi. Le fait d’être embauché en CDI accroît la probabilité qu’un jeune décohabite. Les plus diplômés accèdent également plus tôt à un logement en autonomie. Être jeune ne renvoie pas donc à la même réalité, ce qui explique l’efficience des actions locales, plus à même de saisir les particularités territoriales. Ces actions permettent de dépasser l’apparente homogénéité du groupe social “jeune”. 34% des jeunes occupant un logement autonome sont concernés par le phénomène de pauvreté monétaire*. Cela s’explique par le montant important des loyers dans les grandes villes, ce qui pèse fortement dans le budget des jeunes. Pour les jeunes sans emploi décohabitant, le taux de pauvreté monétaire s’élève à 56%. L’ouverture des droits au RSA à 25 ans permet à ces jeunes sans emploi de recevoir une allocation fixe, ce qui constitue un facteur différenciant important en comparaison avec les jeunes de moins de 25 ans sans emploi.
Ils se distinguent par le type de logements recherchés, à savoir des meublés pour une courte durée, principalement dans le parc locatif privé. Alors que ce parc ne représente qu’un quart des résidences principales pour la population totale, 70% des moins de 25 ans y logent, et 50% des 25-29 ans. Le rapport note un faible taux de personnes de moins de 30 ans en demande de logement social comparativement aux ressources dont ils disposent. Cela s’explique en partie par le faible taux de rotation pour une population dont la mobilité est fréquente. Cela a des implications financières importantes, puisque les propriétaires peuvent augmenter les loyers à la fin de chaque bail. En région parisienne, les personnes ayant déménagé récemment payent en moyenne 22% de plus que les personnes occupant un logement depuis plus de 10 ans. Enfin, les studios sont en moyenne 21% plus chers au mètre carré que les autres types de logements.
Historiquement, les politiques publiques du logement pour les jeunes se sont concentrées sur le logement à destination des étudiants. Le nombre de logements dans des résidences universitaires s’élève à 385 000, ce qui permet de loger 12% des étudiants et 20% des décohabitants de moins de 30 ans. Il y a 175 000 logements gérés par le CROUS dont la moitié appartient à des bailleurs sociaux, 70 000 logements sociaux et 140 000 résidences privées à loyers libres. On compte également 30 840 places dans des internats pour étudiants. Le SIAO peut orienter sur 157 logements, soit 167 places dans les résidences étudiantes. Pour plus de précisions sur les dispositifs jeunes du pôle Insertion du SIAO, vous pouvez lire cet article en cliquant ici.
Le premier critère d’accès est la détention d’un certificat de scolarité valide. L’attribution de la bourse est déterminante pour accéder au logement étudiant. En effet, les boursiers ont la priorité pour recevoir un logement du CROUS. Sur l’année universitaire 2022-2023, ils étaient 665 000 étudiants boursiers et représentaient 54% des locataires en résidence étudiante contre 5% pour les étudiants non boursiers. Les APL sont le premier soutien public aux jeunes. Ils constituent une aide indispensable pour permettre aux jeunes de se loger.
II. Un soutien fragmenté à mieux coordonner
Mis à part pour les étudiants, le rapport observe que les personnes de moins de 30 ans ne sont pas l’objet d’une politique du logement commune. Elle s’adresse à des groupes particuliers au sein des jeunes. A titre d’exemple, les politiques d’accompagnement des jeunes travailleurs précaires. Cependant, le rapport observe un engagement discontinu de l’État envers les jeunes non-étudiants. Les Foyers Jeunes Travailleurs et Résidences Jeunes Actifs (cf l’article Les dispositifs Jeunes sur le Val-d’Oise en 2024 en cliquant ici), qui ont vocation à accueillir les jeunes travailleurs représentent 68 000 places sur le territoire, soit quatre fois moins que le nombre de places à destination des étudiants alors que les personnes de 21 à 30 ans sont majoritairement en emploi.
Des initiatives ont été portées afin de favoriser l’accès des jeunes au parc social, en permettant par exemple des colocations dans du logement social. Cependant, cela reste marginal puisqu’ils représentent 0,06% des ménages en logement social. La loi ELAN de 2018 offre la possibilité de réserver une partie du parc aux personnes de moins de 30 ans. La mise en place de ce dispositif a encore des effets limités à ce jour. Plusieurs facteurs expliquent cette situation. Les bailleurs activent ces dispositifs sur les nouvelles constructions et de façon marginale sur le parc préexistant. L’attente longue pour se voir attribuer un logement social ne correspond pas à la mobilité contrainte de ce public. Enfin, le parc social est affublé d’une représentation négative par les personnes de moins de 30 ans. Plusieurs bailleurs ont mis en place des actions de communication visant ce public afin de “redorer leur blason”. Étant donnée la proportion de personnes de moins de 30 ans occupant un logement locatif privé, les politiques publiques mettent en place des dispositifs afin de permettre l’accession à ce type de logements pour les jeunes. Cela passe par exemple par l’encadrement des loyers ou des aides à la mobilité ou la garantie VISALE. Ce dispositif a été intégré rapidement dans les pratiques en réponse à un besoin réel puisqu’il est sollicité à 92% par des jeunes de moins de 30 ans. La loi ELAN a créé le bail mobilité. C’est un bail de 10 mois dans un logement meublé. L’aide Mobili-jeune créée en 2018 répond également à cet enjeu et a pour cible les alternants de moins de 30 ans. Ce dispositif permet aux alternants qui gagnent moins de 80% du SMIC d’obtenir une subvention en complément des APL. Il a été mobilisé par 28,6% des apprentis entre 2018 et 2022.
Plusieurs formes de logements ont vu le jour pour pallier les problématiques rencontrées par les jeunes les plus précaires, afin de baisser le montant des loyers pour ces derniers. La loi ELAN a par exemple institutionnalisé la cohabitation intergénérationnelle, ce qui permet aux personnes de soixante ans et plus de louer une partie du logement qu’elles occupent contre un loyer modeste, en lien avec une association. Ces dispositifs restent marginaux à l’échelle nationale, puisqu’ils concernent 2 600 colocations entre 2018 et 2021. Des dispositifs proposent un accompagnement plus global, en joignant l’accompagnement dans le logement par un accompagnement médico-social ou en vue d’une insertion professionnelle. Il existe ainsi le volet jeunes du programme Un chez soi d’abord qui cible les jeunes sans logement stable et ayant des troubles psychologiques sévères, ou le programme ALEJ qui s’adresse à un public vivant dans des lieux informels (squats, sans-domicile fixe, etc.) en lien avec le service civique. En plus de ces politiques à l’échelle nationale, de nombreux programmes existent à une plus petite échelle. Le développement d’initiatives locales couplées aux politiques nationales implique de nombreux acteurs, ce qui peut représenter un frein à l’insertion des jeunes.
Le rapport observe une fragmentation des actions publiques qui complexifie l’accès à l’information sur ces dispositifs. L’enjeu est d’éviter la superposition des dispositifs, accompagnants et vecteurs d’informations.
Le rapport propose de reprendre le fonctionnement des observatoires territoriaux du logement étudiant en le généralisant aux personnes de moins de 30 ans. Ces observatoires locaux ont pour objectif de produire des diagnostics afin d’appréhender les enjeux et besoins des étudiants. Ils agissent en relation avec les exécutifs locaux dans l’élaboration des Programmes Locaux de l’Habitat. Étendre les missions de ces observatoires à l’ensemble du public jeune permettrait une meilleure cohérence et coordination dans l’accompagnement vers le logement des personnes de moins de 30 ans. Cela existe déjà sur certains territoires, notamment en Occitanie, avec un observatoire pour le logement des jeunes. Le rapport appelle cependant à la prudence pour maintenir une gouvernance locale et partagée sur ces instances afin de mieux coller aux différentes réalités territoriales.
Ce rapport permet d’identifier de manière plus fine les sous-groupes chez les 18-30 ans et les spécificités inhérentes à ces groupes. Les besoins de ce public ne sont pas différents de la population générale, à savoir l’accès à un logement abordable et proche du lieu de leur activité. Cependant, les situations de mobilité contrainte et les faibles revenus complexifient l’accès au logement. Les approches visant à déconstruire la catégorie “jeunes” pour mettre en place des dispositifs dédiés à une part de ce public se développent, notamment à destination des jeunes travailleurs précaires.
Les actions portées localement à travers une territorialisation des démarches permettent de prendre en compte les réalités multiples propres à ce public, plus hétérogène qu’il n’y parait. Le rapport note le besoin de renforcer la coordination et de mettre en œuvre une gouvernance à l’échelle locale comme ce fut le cas pour le logement étudiant. Cette coordination permettrait une valorisation des expériences locales réussies, ainsi qu’une mise en réseau des acteurs locaux. La Cour des comptes formule une recommandation, à savoir « capitaliser et diffuser régulièrement à l’échelle nationale les bonnes pratiques en matière d’accès au logement des jeunes » (Cour des comptes, p. 281).
POUR ALLER + LOIN
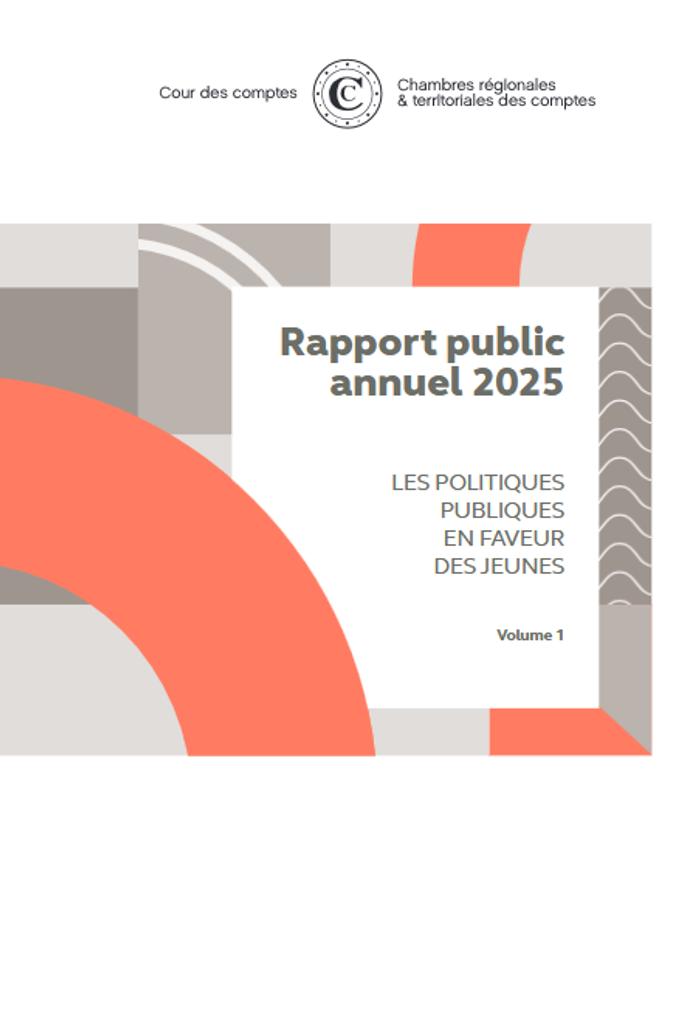

Téléchargez :
✔️ le Rapport 2025 complet Les politiques publiques en faveur des jeunes. Volume 1, en cliquant ici.
✔️ Le chapitre dédié à l’accès des jeunes au logement, en cliquant ici.

