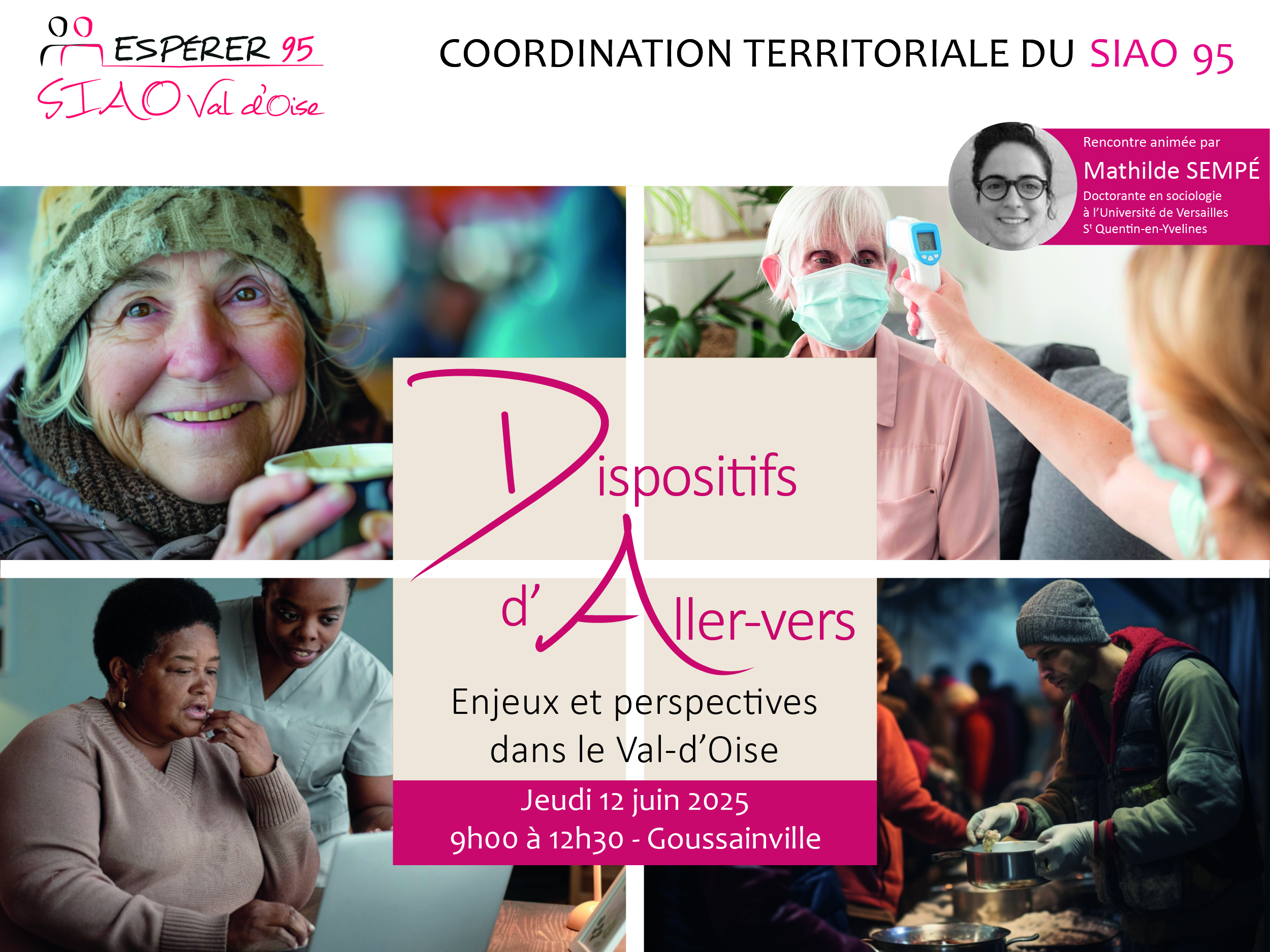Organisée à la Maison Pour Tous de Goussainville, cette Coordination Territoriale Semestrielle (CTS) avait pour objet l’Aller-Vers comme modalité d’intervention dans le travail social.
Plus généralement, cette instance de coordination favorise une dynamique d’interconnaissance entre les acteurs de l’AHI (Accueil-Hébergement-Insertion).
La CTS a démarré par une introduction conjointe de Mme CHARENTON, adjointe au maire en charge des Nouvelles Solidarités et du Troisième âge et de Mme PELISSIER, directrice du SIAO. S’en est suivi une présentation socio-historique de cette modalité d’intervention par Mathilde SEMPÉ, doctorante en sociologie à l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines.
Si la posture d’aller-vers un public n’est pas une nouveauté dans le secteur social, nous constatons une multiplication des équipes mobiles. Comment expliquer ce phénomène ? Quelles sont les implications sur le public, le travail social et les travailleurs sociaux ?
- Le travail social hors-les-murs, une nouveauté ?
Les années 1980 ont été marquées par deux phénomènes favorisant le développement de la notion d’aller-vers dans le travail social. D’abord, une saturation et une superposition des dispositifs d’aide sociale, complexifiant l’accès aux dispositifs d’accompagnement social et faisant émerger la problématique du « non-recours ». En parallèle, il y a une volonté politique de maitriser les coûts des politiques publiques.
La décennie 1990 est marquée par l’émergence de dispositifs d’aller-vers spécialisés avec la création des maraudes du Samusocial de Paris, notamment en réponse à la stabilisation du taux pauvreté, jusqu’alors décroissant, à partir de la fin des années 1980 et jusqu’au milieu de la décennie 90. Les années 2000 constituent un tournant pour l’aller-vers par la mise en avant de cette forme d’intervention dans les politiques publiques. En 2005, les premières équipes créées par une circulaire (1) apparaissent sur l’ensemble du territoire national, les Equipes Mobiles Psychiatrie Précarité (EMPP).
Progressivement, les politiques publiques intègrent cette modalité d’intervention au cours de la décennie 2010 et 2020. La France n’est pas seule dans cette dynamique puisqu’en 2010, une recommandation du comité des ministres de l’Europe encourage une désinstitutionalisation des personnes en situation de handicap en favorisant le développement des équipes mobiles. A titre d’exemple, nous pouvons citer les Etats généraux du travail social en 2013 dans lesquels est énoncée la volonté de “faire émerger les compétences des personnes accompagnées”. Pour parvenir à cet objectif, l’un des leviers est le développement d’“une politique d’aller vers”. En 2018, avec la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté (2), l’Etat positionne la démarche d’aller-vers comme un axe fort, notamment en réponse à l’accroissement du non-recours. En effet, l’aller-vers est pensé comme une stratégie permettant de faire émerger des demandes en investissant un territoire spécifique, à l’image des équipes de prévention spécialisée. Le début des années 2020, marquée par le confinement lié au COVID, consacre définitivement l’aller-vers. Le Haut Conseil du Travail Social (3) montre que la crise a, paradoxalement, permis aux professionnels « de développer un certain nombre de pratiques nouvelles visant à atténuer les effets de l’éloignement, voire de la rupture de contact ». Le travail social s’inscrit dans une tendance de fond puisque les champs médical et médico-social se dotent de plusieurs équipes mobiles, conjuguant santé et précarité. La stratégie nationale de santé pour la période 2018/2022 affirme un virage ambulatoire dans le secteur de la santé et promeut les dispositifs d’aller-vers pour les personnes les plus éloignées du système de santé. Parallèlement, la mesure 27 du Ségur de la santé de 2020 (4) débouche sur la création de 5 nouveaux types d’équipes mobiles : les Equipes Mobiles Santé Précarité (EMSP), les Permanence d’Accès aux Soins de Santé mobiles (PASS), les Lits Haltes Soins Santé mobiles (LHSS), les Appartements de Coordination Thérapeutique « hors les murs » (ACT HLM) et les équipes de soins infirmiers précarité (ESSIP). L’aller-vers comme méthode d’intervention est désormais pleinement intégrée aux politiques publiques.
2. Définitions de l’aller-vers
La multiplication des équipes fonctionnant sur le principe de l’aller-vers dans le travail social implique un renouvellement de la posture professionnelle, ce qui a fait naitre un besoin de définition conceptuelle. Ainsi, des définitions universitaires, institutionnelles ou émanant du terrain ont émergé.
« C’est une démarche par laquelle les travailleurs sociaux et les intervenants sociaux sont conduits à sortir physiquement de leur structure pour aller à la rencontre des populations isolées ou ayant « décroché » afin de rétablir un lien et l’accès aux aides et au droit commun, en se tournant vers leurs lieux de vie. L’« aller-vers » a donc deux dimensions principales : une mobilité hors-les-murs vers les milieux de vie, et une posture relationnelle d’ouverture vers la personne alors qu’elle renonce à être aidée (sans jugement a priori sur celle-ci). » — Cyprien Avenel (2023)
« C’est une action, un déplacement qui conduit à se mettre en lien sans s’imposer. Il faut pouvoir se mettre à la portée de la personne en l’écoutant. Pour réussir la rencontre, il faut être vigilant sur le « démarrage » de la relation. Cela demande une forme d’engagement qui nécessite de s’adapter, d’être disponible et bienveillant. Il faut pour aller-vers accepter l’incertitude qui provoque de l’insécurité et met dans une zone d’inconfort. » — Groupe de travail dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté
« L’aller vers est à entendre comme une démarche qui se situe au-delà de toute intervention sociale, qu’elle soit d’accueil, de diagnostic, de prescription, d’accompagnement. Cette démarche rompt avec l’idée que l’intervention sociale ferait systématiquement suite à une demande exprimée. Elle permet d’intégrer dans les pratiques les situations de non-demande de certains publics (pas seulement des personnes vulnérables) et engage les acteurs à se situer dans une pratique proactive, pour entrer en relation avec ces publics. » — Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté
Plusieurs éléments communs apparaissent dans ces définitions :



L’aller-vers, en tant que posture, peut dès lors constituer une solution pour faire émerger un nouveau public qui, pour des raisons diverses, ne sollicitent plus les aides sociales auxquelles il pourrait prétendre. Cependant, cette démarche proactive a des implications sur le nécessaire consentement des personnes accompagnées. La démarche d’aller-vers s’accompagne donc d’une dimension réflexive des travailleurs sociaux sur leurs pratiques professionnelles et leur positionnement face à leur public. La CTS organisée sur cette thématique a permis d’aborder ces questions, proposant des pistes de réflexion, des interrogations ou encore des solutions trouvées à partir des pratiques professionnelles.
Finalement, nous pouvons constater que la démarche d’aller-vers constitue une réponse aux enjeux auxquels sont confrontés les travailleurs sociaux : augmentation du non-recours, accroissement et diversification des formes de précarité et des publics concernés (ex. personnes âgées, familles monoparentales, etc.).
3. L’aller-vers dans le Val-d’Oise
Cette multiplication des équipes mobiles conduit à une complexification de l’écosystème partenarial des travailleurs sociaux. La connaissance de ces dispositifs par ces derniers devient donc un enjeu fort pour proposer un accompagnement adapté des publics.
Le territoire valdoisien illustre bien cette dynamique puisque nous recensons 51 dispositifs d’aller-vers dans le département qui couvrent une multitude de publics et problématiques. Il existe 27 dispositifs dédiés à l’insertion des publics (scolaire, par le logement, professionnelle ou d’accès aux droits), 10 dispositifs relèvent de la veille sociale (maraudes sociales, maraudes réduction des risques) et 14 sont identifiés comme appartenant au sanitaire et social (EMSP, ESSIP). Le détail de l’ensemble de ces dispositifs est disponible dans le référentiel des équipes mobiles du Val d’Oise
 PPT CTS Aller-Vers-Presentation OS du SIAO
PPT CTS Aller-Vers-Presentation OS du SIAO
Pour aller plus loin sur l’historicité de cette forme d’intervention, vous pouvez, pour les abonnés CAIRN, consulter l’article L’aller-vers : sources et trajectoire. Vers un nouveau modèle de travail social ?
(1) CIRCULAIRE N°DHOS/O2/DGS/6C/DGAS/1A/1B/521 du 23 novembre 2005
(2)Les cinq engagements de la Stratégie pauvreté | solidarites.gouv.fr | Ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles
(3) hcts-_le_travail_social_face_a_la_crise_sanitaire_20210125_vdef.pdf
(4) Des mesures dédiées à la précarité dans le Ségur de la santé | solidarites.gouv.fr | Ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles
Le choix de ce thème s’inscrit dans une dynamique de multiplication des équipes mobiles et de leurs champs d’intervention. La démarche d’« aller-vers », bien que présentée comme innovante, s’ancre dans une histoire longue du travail social. L’inflation de l’usage de ce concept correspond à un développement récent des équipes mobiles à destination des personnes en situation de précarité, notamment à travers la mesure 27 du Ségur de la Santé et la Stratégie Nationale de lutte contre la pauvreté de 2018.
Dans ce contexte, plusieurs objectifs ont été poursuivis lors de cette journée : faire connaitre les dispositifs existants, mutualiser les expériences, enrichir les pratiques professionnelles et renforcer la coordination entre dispositifs mobiles et fixes.
Table 1 Aller-vers : l’action sociale en mouvement
Intervenants : Tabila BELLARIF – Psychologue de l’EMP 95 (Aurore) ● Hussein DRIF – Coordinateur de l’Équipe Mobile Charles de Gaulle (Croix-Rouge française) ● Pauline STAHL – Coordinatrice AVDL / FNAVDL (ARS 95)

La première table-ronde a réuni des professionnels appartenant à un dispositif utilisant l’aller-vers comme modalité d’intervention, sans que ces derniers aient le même public, champ d’action, missions, etc. L’objectif recherché étant de montrer l’étendue et la diversité des publics desservies par des équipes utilisant une modalité d’intervention commune. Ainsi, cela a permis de rechercher les points convergents entre eux afin de faire ressortir l’essence de ce qu’implique une intervention sous la forme de l’“aller-vers”.
Un des points centraux de l’aller-vers est le fait d’investir le lieu de vie des personnes accompagnées, rompant avec la logique de guichet où se rendre pour initier un accompagnement social. Cela implique un renouvellement de la posture professionnelle. Faire émerger une demande d’un public en situation de non-recours requiert du temps et induit une nécessaire persévérance des travailleurs sociaux. De plus, une mauvaise appréciation de la distance entre le professionnel et la personne accompagnée peut être vécue comme une intrusion, d’où l’importance d’un travail sur la posture à adopter et donc d’assurer une formation spécifique des professionnels. À titre d’exemple, lors d’une situation évoquée par Mme STAHL, la visite à domicile a permis de déceler un syndrome de Diogène* qui n’aurait pu être diagnostiqué sans cette modalité d’intervention et aurait pu faire échouer l’accompagnement social de cette personne.
Le deuxième impact notable de l’aller-vers, évoqué par Mme BELLARIF de l’EMP 95 d’Aurore, concerne le portage de la souffrance des publics par les professionnels eux-mêmes. Cette souffrance, accumulée, peut être vecteur de mal-être au travail. Là encore, la distance adéquate est un exercice d’équilibriste. Or, cette souffrance des travailleurs sociaux peut empêcher la mise en œuvre d’un accompagnement de qualité.
Le troisième point saillant réside dans le public visé, souvent en situation de non-recours sur le territoire. Ce sont donc potentiellement des personnes dans une situation d’exclusion sociale et de précarité extrême. Cela nécessite une présence renforcée et renouvelée des travailleurs sociaux. C’est par exemple le cas des professionnels de l’Équipe Mobile Charles de Gaulle, présenté par Mr DRIF, coordinateur de cette maraude. Ces derniers travaillent auprès d’un public avec peu de perspectives de réinsertion à court ou moyen terme.
Enfin, les trois participants ont noté l’importance de leur articulation avec l’écosystème de l’AHI et du secteur médical, afin d’être relayée par les structures fixes. En outre, ces équipes ont pour vocation de ramener vers le droit commun les personnes accompagnées. La coordination est donc au fondement de la pratique des équipes mobiles.
Table 2 Quand l’aller-vers rencontre le droit commun : quelle articulation des dispositifs ?
Nous ne détaillerons pas les situations, l’objectif du présent article est d’en faire ressortir les points saillants.
Intervenants : Katty MUHEL – Cheffe de service 115-Cellule Mobile 115 (SIAO 95) ● Aurélie MONEME-STERN – Coordinatrice Cellule Mobile 115 (SIAO 95) ● Marie-Anne LAGACHA – Responsable de territoire Gonesse/Villiers-le-Bel (SSD) ● Aurore FROMONT – Directrice du pôle Habitat et Accès au Logement (ESPÉRER 95) ● Eva MASSON – Cheffe de service de la PASH 95 (ESPÉRER 95) ● Sylvie LORIDAN – Cadre de santé de l’EMSP (ESPÉRER 95) ● Hamza LAHRACH – Infirmier de l’ESSIP (Fondation Léonie Chaptal) ● Emilie DUVAL – Responsable de la mission d’appui à l’encadrement des territoires EST (SSD)

La seconde table-ronde avait pour thème la coordination des équipes mobiles entre elles et avec les service fixes. Le choix a été fait de partir de situations concrètes afin d’en retirer les bonnes pratiques, montrer les limites de cette forme d’intervention et faire découvrir des modalités de coopération locales qui ont permis d’améliorer la prise en charge de situations complexes.
L’augmentation du non-recours nécessite une adaptation du travail social, afin de mettre en lumière les publics en situation de vulnérabilité et initier un accompagnement social. Dans cette visée, les interventions de la Cellule Mobile 115 ou encore d’une EMSP ont permis de visibiliser des situations qui auraient pu passer sous les radars et déboucher sur une aggravation et/ou un empilement des vulnérabilités. L’intervention des équipes mobiles semble donc particulièrement pertinente pour initier une prise en charge des publics invisibilisés. Le déplacement sur le lieu de vie donne la capacité de mettre en lumière ces publics. Cette action est un prérequis afin de ramener vers les dispositifs fixes mais n’est pas la seule condition puisque cela nécessite une coopération partenariale.
La coordination comporte plusieurs enjeux. L’un d’eux est de dépasser la relation interpersonnelle sur laquelle s’établit une relation partenariale. Une dynamique partenariale reste par essence fragile tant qu’elle s’établit autour de deux personnes. De plus, faire reposer une coordination à un niveau individuel est chronophage pour les personnes concernées. Il convient d’instituer des instances de régulation et de coordination des actions afin d’assurer une continuité dans la relation partenariale au-delà de la connaissance interpersonnelle.
Comme évoqué lors de la table ronde, quant à l’accompagnement des personnes vieillissantes ou en perte d’autonomie et face à des situations complexes, la coordination entre acteurs ne permet pas toujours de dépasser les limites structurelles inhérentes au manque de moyens dans le travail social. La seule dynamique partenariale ne suffit pas à répondre aux enjeux de cet accompagnement. Toutefois, la mise en commun des connaissances entre travailleurs sociaux permet tout de même de faire avancer certaines situations.
Enfin, l’articulation entre équipes mobiles et services fixes ne peut fonctionner si ces derniers ne sont pas capables d’absorber le public que fait émerger les équipes mobiles, puisque, pour partie d’entre elles, elles visent un public en situation de non-recours. De plus, l’aller-vers implique des services fonctionnels, prêts à prendre le relai des équipes mobiles. Si ce n’est pas le cas, cela peut être source de frustration pour les équipes ayant initié un accompagnement sans qu’une suite puisse être donnée.
Conclusion
L’« aller-vers » est une pratique précieuse, mais fragile. Elle redonne un visage humain à l’action sociale par sa proximité avec le public. La CTS a permis de montrer la richesse des pratiques, la complexité croissante des situations et la nécessité d’une approche partenariale renforcée.
L’aller-vers constitue un levier majeur pour rendre visibles les invisibles, mais ne peut réussir sans moyens humains, logistiques et institutionnels adaptés. Les discussions ont montré que la synergie des dispositifs permet, dans un contexte budgétaire contraint, d’offrir des parcours ascendants à des personnes jusque-là invisibilisées. Le partenariat reste le levier majeur pour garantir la continuité, la cohérence et la pertinence des accompagnements. Les professionnels doivent être soutenus, reconnus et outillés pour tenir cette posture exigeante.
Cette CTS n’aurait pu se tenir sans la présence de nos partenaires. Nous sommes particulièrement reconnaissants envers les participants ayant accepté d’apporter leur expérience du terrain. Nous remercions également la mairie de Goussainville, et notamment Mme CHARENTON, adjointe au maire en charge des Nouvelles Solidarités et du Troisième âge pour sa présence, ainsi que les agents municipaux nous ayant aidé pour l’installation de la salle. Nous remercions l’ensemble des équipes du SIAO qui ont permis de mettre en œuvre cette journée. Enfin, merci à Mathilde SEMPÉ pour son investissement dans l’organisation et sa participation à cette CTS.
POUR ALLER + LOIN
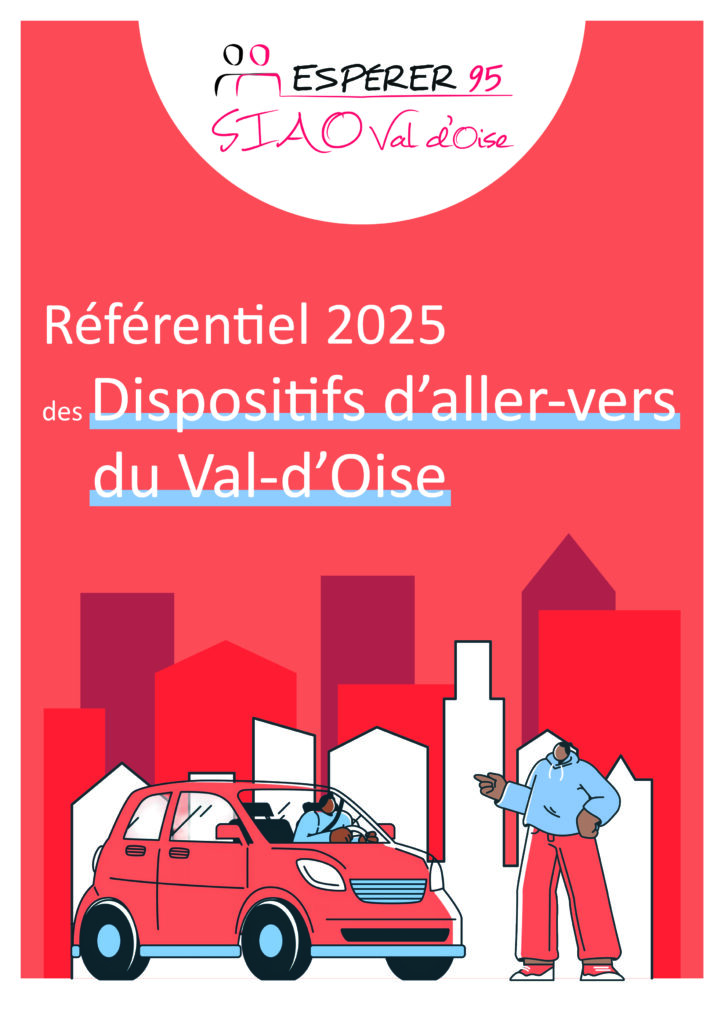
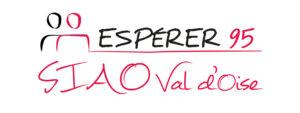
RÉFÉRENTIEL 2025
DES DISPOSITIFS D’ALLER-VERS DU VAL-D’OISE
Élaboré dans la cadre de cette Coordination Territoriale Semestrielle (CTS) du SIAO 95, ce livret recense les équipes mobiles volontaires, intervenant sur les champs de la veille sociale, du sanitaire et social et/ou de l’insertion.
Conçu comme un outil pratique, il s’adresse à l’ensemble des professionnels de l’AHI, ainsi qu’à tous les partenaires institutionnels et associatifs. Il vise à faciliter l’orientation des publics, à soutenir les professionnels dans leur travail quotidien et à renforcer les coopérations entre acteurs.
À télécharger en cliquant ici.